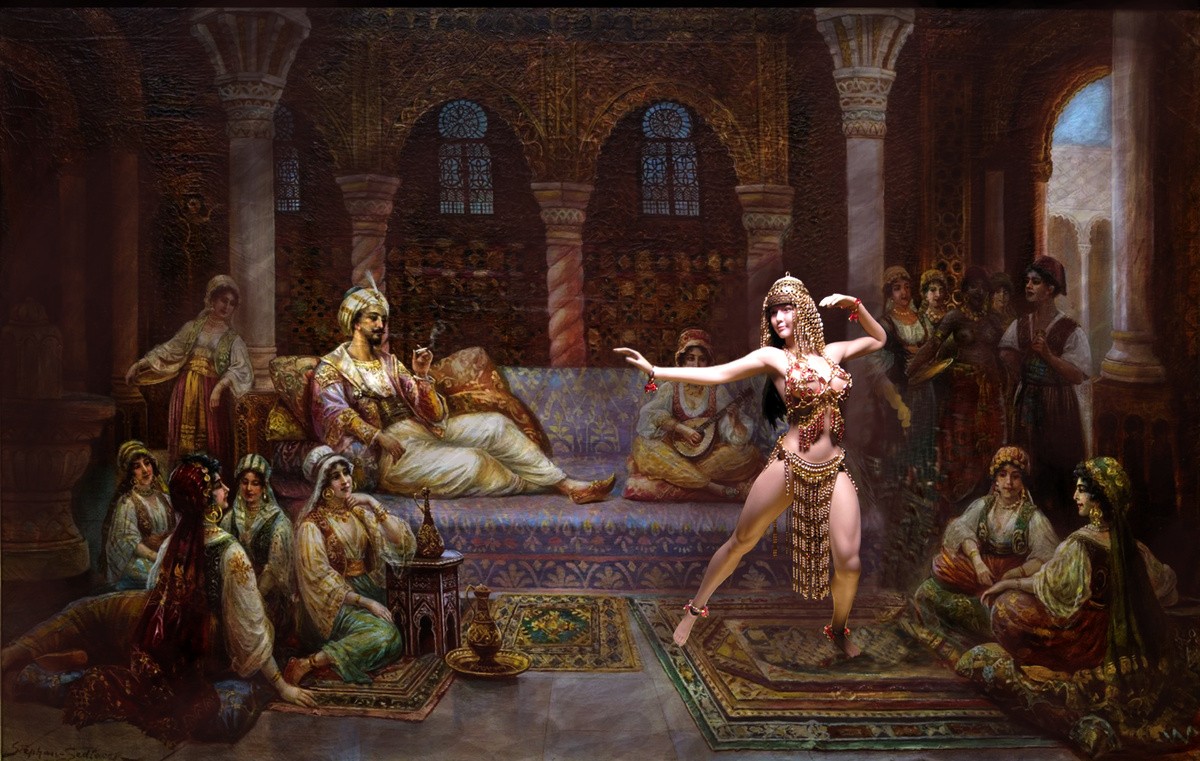Quand les captives deviennent des biens de guerre : les harems suivent les armées et les femmes deviennent des objets
Malgré l’apparente romance des séries historiques, la réalité des sociétés anciennes était brutale : une femme n’était pas toujours vue comme une personne, mais comme une chose. Lors des conquêtes, les harems pouvaient devenir des trophées; épouses et filles étaient redistribuées, offertes à des proches ou utilisées comme instruments de pouvoir. Pourtant, certains destins furent plus nuancés : si le nouveau maître estimait la captive utile ou précieuse, elle pouvait conserver une certaine dignité ou obtenir une place plus sûre. Cette histoire ne raconte pas une seule dynamique, mais un éventail de situations où le pouvoir et le genre se mêlent à la violence et au hasard.

In This Article:
- Les harems en temps de guerre : pourquoi ils ne partent pas toujours en campagne
- 1243, Kes-Dag : le destin du hare m du sultan de Konya entre Mongols et Seldjoukides
- Chaldiran (1514) : des récits divergents sur le sort des harems
- Timour, Saray-mulk Khanum et l’étrange variabilité des destins féminins
Les harems en temps de guerre : pourquoi ils ne partent pas toujours en campagne
Très peu de souverains emportaient leurs courtisanes sur les fronts : c’était long, complexe et ralentissait l’armée. En chemin, on pouvait croiser des paysannes séduisantes — et les harems restaient alors souvent à l’abri, loin du front et des bombardements de voleurs et de pillards. Cependant, chez les peuples turco-mongols, qui vivaient selon un mode de nomadisme vigoureux, chaque guerre était quasi une grande migration, et le harem accompagnait l’armée comme un élément de la tribu móvil.
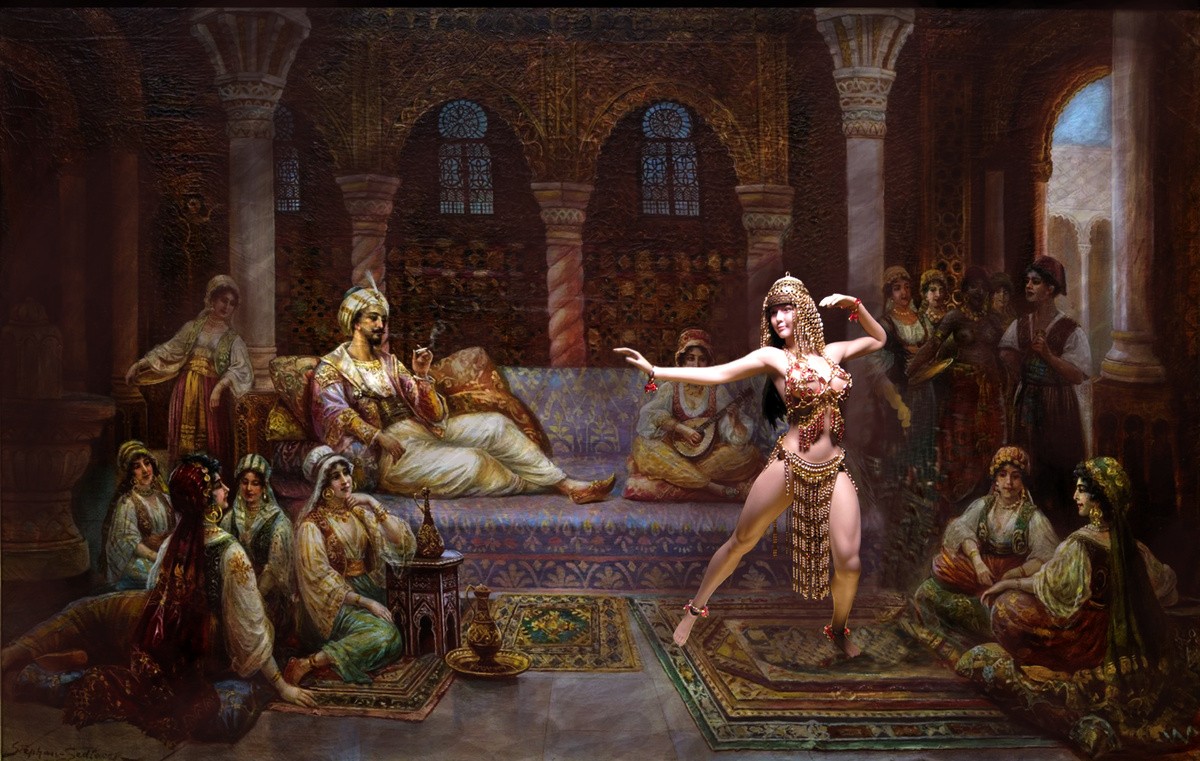
1243, Kes-Dag : le destin du hare m du sultan de Konya entre Mongols et Seldjoukides
Lors de la bataille entre les Seldjoukides et les Mongols près du mont Kes-Dag, le temnik mongol Baïdjou écrase l’armée du sultan de Konya et prend en captivité son immense hare m. La principale épouse géorgienne, Gurju-khatun, fut traitée avec respect et rendue à son mari après la signature d’un traité. Le sultan Kai Khusrov II accepta de céder la moitié de ses territoires et de payer un tribut. Mais les Mongols avaient pour habitude de répartir femmes et filles parmi leurs frères et leurs fils ; une autre pratique était d’impliquer des princesses lors d’invasions, comme lors de l’expédition contre le Ryazan où le général Baïdjou aurait exigé, vivant, que le mari du harem livre la princesse byzantine Eupraxie.
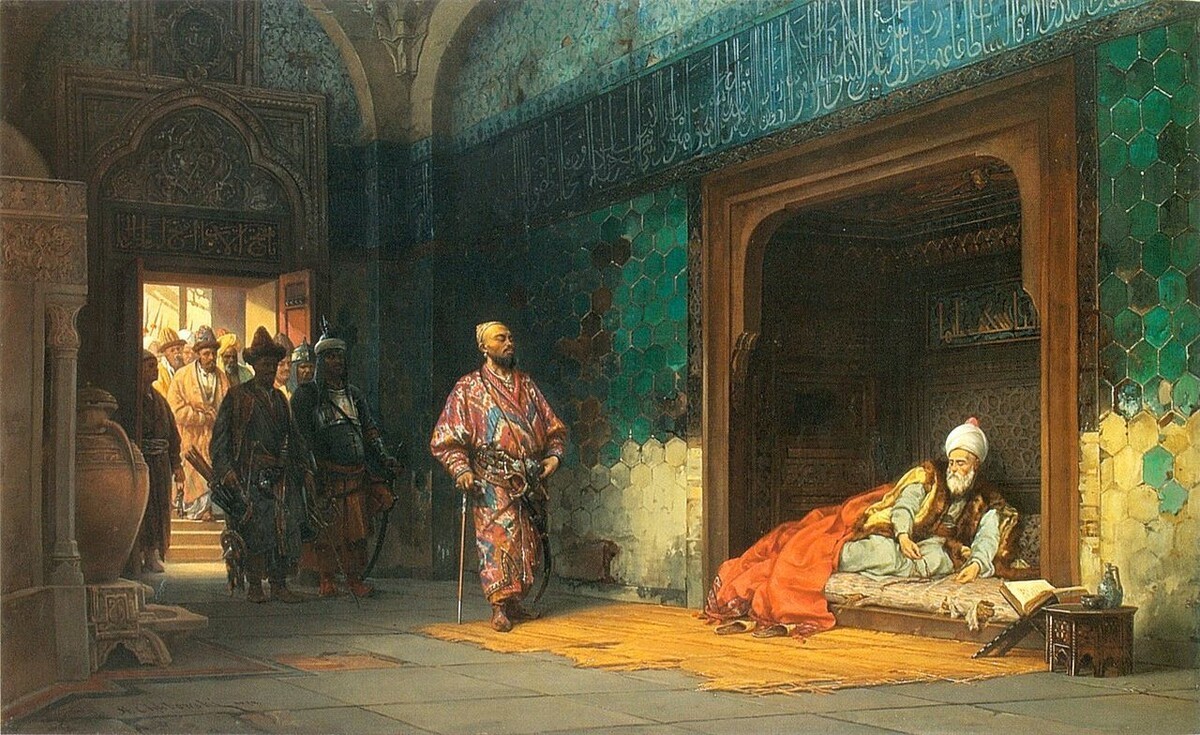
Chaldiran (1514) : des récits divergents sur le sort des harems
Lors de la victoire de Selim Ier et de la bataille de Chaldiran, le harem du shah Ismaïl tomba entre les mains des Ottomans : Tajly-hatun et Behruze-khanum furent pris. Les sources divergent : les Européens affirment que la princesse serbe Olivera fut obligée de servir au banquet des vainqueurs en tenue négligeante, tandis que certains chroniqueurs ottomans décrivent une humiliation marquée par des barreaux de cage. L’historien Ibn Arābshāh, fait prisonnier par Timour, affirme au contraire que la sultane reçut tout le respect possible. D’autres chroniqueurs samarcandais rapportent des conclusions similaires. Finalement, Olivera fut libérée grâce à l’intervention des envoyés de son frère serbe.

Timour, Saray-mulk Khanum et l’étrange variabilité des destins féminins
Après la conquête, Timour prit Saray-mulk Khanum, épouse de l’émir Husayn qu’il avait tué. Ils vécurent ensemble près de quarante ans, et cette femme ne conserva que peu de souvenirs de son premier mari. L’anthropologue Drobyshevsky raconte aussi une histoire qui semble venir de Papouasie-Nouvelle-Guinée ou d’Australie : des groupes attaquaient un village pour prendre les femmes, et selon le récit, ces femmes aidèrent les assaillants à éliminer leurs propres maris. Ces exemples — réels ou transmis par les légendes — montrent la diversité des destins féminins dans les sociétés guerrières et invitent à réfléchir sur ce que signifie “protéger l’honneur” dans un contexte de violence et de conquête.